Compte-rendu du livre Comment tout a commencé. La naissance du christianisme d’Enrico Norelli
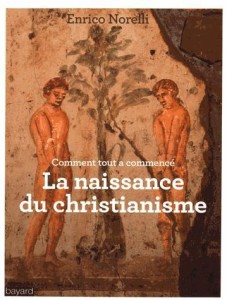 Professeur à la Faculté de théologie de l’Université de Genève, spécialiste reconnu des origines du christianisme et de la littérature chrétienne ancienne, Enrico Norelli est l’auteur de nombreuses monographies et de plusieurs articles dans le domaine du christianisme ancien[1]. Il a également co-édité divers ouvrages dont une importante Histoire de la littérature grecque chrétienne (2 volumes) avec Bernard Pouderon (Université François-Rabelais, Tours) aux Éditions du Cerf (2008-2013) dans la collection « Initiation aux Pères de l’Église », de même qu’un ouvrage sur Jésus de Nazareth. Nouvelles approches d’une énigme avec Daniel Marguerat (Université de Lausanne) et Jean‑Michel Poffet (École biblique et archéologique française de Jérusalem) aux Éditions Labor et Fides (1998).
Professeur à la Faculté de théologie de l’Université de Genève, spécialiste reconnu des origines du christianisme et de la littérature chrétienne ancienne, Enrico Norelli est l’auteur de nombreuses monographies et de plusieurs articles dans le domaine du christianisme ancien[1]. Il a également co-édité divers ouvrages dont une importante Histoire de la littérature grecque chrétienne (2 volumes) avec Bernard Pouderon (Université François-Rabelais, Tours) aux Éditions du Cerf (2008-2013) dans la collection « Initiation aux Pères de l’Église », de même qu’un ouvrage sur Jésus de Nazareth. Nouvelles approches d’une énigme avec Daniel Marguerat (Université de Lausanne) et Jean‑Michel Poffet (École biblique et archéologique française de Jérusalem) aux Éditions Labor et Fides (1998).
C’est donc en terrain connu qu’Enrico Norelli nous présente sa plus récente synthèse sur les origines du christianisme et sur les premières communautés chrétiennes. Dans cet ouvrage, paru d’abord en italien (2014)[2], il tente de cerner les principaux facteurs qui ont permis au mouvement des disciples de Jésus – qui deviendra ultérieurement le christianisme – de se répandre et de perdurer dans le temps, alors que d’autres mouvements (ou courants) de la même époque – issus tant du judaïsme que du christianisme « naissant » – n’y sont pas parvenus. Comment alors expliquer que le mouvement des disciples de Jésus, marginal dans le judaïsme du Ier siècle et dans l’Empire romain avant le IIIe siècle, ait réussi en si peu de temps, soit en moins de quatre siècles, à s’imposer, voire à s’ériger comme l’unique religion institutionnalisée de l’Empire romain ? Si la question n’est pas nouvelle – pensons, entre autres, au célèbre Génie du christianisme de François‑René Chateaubriand (1802) –, Enrico Norelli tente d’y apporter une réponse d’historien, et non de théologien (ou de croyant). En se basant sur des explications socio-historiques – et non sur la justification que la puissance de l’Esprit saint aurait permis le « triomphe » du christianisme – Enrico Norelli présente le christianisme comme un mouvement (ou des mouvements) en marche dans l’attente d’un Royaume qui ne viendra finalement pas.
À travers cette « naissance » du christianisme, il souligne la complexité à travers laquelle se sont progressivement construites, d’une part, ce qu’il désigne comme l’« identité chrétienne » en opposition avec l’« identité judaïque » (par exemple p. 84) – ou, en d’autres termes, le christianisme en opposition avec le judaïsme – et, d’autre part, l’autorité normative – ou mono-épiscopale – de l’« Église » qui a tenté d’affirmer son autorité aux dépens d’autres courants chrétiens désignés comme « hérétiques » ou « gnostiques » et relayés aux marges d’un christianisme présenté comme « orthodoxe ». Dans cette perspective, il affirme avec raison que « la “naissance du christianisme” n’est pas le surgissement soudain à la lumière d’un individu déjà plus ou moins formé, mais un ensemble complexe mêlant développements, expériences, rencontres, affrontements, négociations culturelles, synergie, opérations idéologiques et affirmation de pouvoir » (p. 14). Enrico Norelli présente ainsi le christianisme comme une émergence de sens – ou comme l’émergence d’une mémoire et d’une doctrine collectives – négociée de manière très virulente entre les différentes composantes/mouvances du christianisme ancien. C’est donc cette complexité que l’auteur tente de décrypter en progressant à la fois thématiquement et chronologiquement à travers les six chapitres qui composent son ouvrage afin de comprendre les principales clés du succès chrétien et les diverses mémoires qui ont été construites par différentes communautés chrétiennes au cours des deux premiers siècles de notre ère.
Sans nécessairement apporter une grande nouveauté en la matière, l’ouvrage d’Enrico Norelli offre néanmoins un portait vulgarisé, nuancé, clair, synthétique et surtout accessible à un large public des premiers mouvements/premières tendances qui se sont réclamés de la figure de Jésus de Nazareth et qui ont interprété, de manière diverse, le message qu’il a transmis à ses disciples. Sans reprendre l’ensemble de l’argumentaire de l’auteur, soulignons d’abord les principales idées de cet ouvrage avant de s’attarder sur les quelques faiblesses perceptibles et discutables.
En premier lieu, Enrico Norelli souligne que les premiers témoignages des disciples reposent sur une « volonté de légitimer Jésus et de se légitimer eux-mêmes à travers un travail intense de rassemblement et de reconstruction des souvenirs en les confrontant avec les Écritures qui, pour Israël, faisaient connaître la volonté de Dieu et son mode d’action dans l’histoire » (p. 35). C’est donc une diversité de témoignages qui s’est progressivement construite à partir de l’« héritage de Jésus en terre d’Israël », témoignages qui présentaient des divergences, voire des contradictions importantes sur la compréhension de cet héritage – non seulement entre les évangiles canoniques, mais également entre ces derniers et les évangiles gnostiques et apocryphes rédigés plus tardivement – et qui visaient à assurer une forme de légitimation aux auteurs et communautés qui les ont produits. Ainsi, Enrico Norelli montre bien que l’histoire des premières communautés chrétiennes a été très rapidement marquée par des conflits internes qui opposaient les différentes tendances et communautés chrétiennes entre elles, conflits qui se sont poursuivis tout au long de l’Antiquité.
En second lieu, Enrico Norelli présente les deux dimensions sociologiques qui ont été déterminantes pour l’expansion et la consolidation du christianisme : les missions itinérantes et la formation de groupes sédentaires. Si la première dimension a rapidement permis la diffusion du message chrétien à l’extérieur des frontières d’Israël – contribuant ainsi à sa diffusion hors des communautés juives par distanciation progressive avec le judaïsme – à travers les différentes cités de l’Empire romain, notamment grâce à l’action missionnaire de personnalités charismatiques telles que Paul; la seconde a contribué à assurer une stabilité et une pérennité communautaires par la mise en place progressive de structures ecclésiales et ministérielles d’abord à Jérusalem, notamment autour de la figure de Jacques, frère de Jésus, puis rapidement dans d’importants centres urbains tels qu’Antioche, Rome, Corinthe et Alexandrie. Cette stabilité a permis l’émergence du pouvoir mono-épiscopal, c’est-à-dire l’affirmation du pouvoir de l’évêque sur le collège presbytéral au cours du IIe siècle – pouvoir qu’Enrico Norelli considère comme étant d’abord liée à la responsabilité des finances communautaires – tout en contribuant à la mise en place d’activités de bienfaisance et d’assistance sociale envers de « nombreuses personnes socialement précaires ou abandonnées qui n’auraient pu survivre sans cela de façon honnête » (p. 362-363).
En dernier lieu, Enrico Norelli montre de quelle manière la doctrine chrétienne et le canon biblique se sont progressivement construits à travers de nombreux conflits internes au christianisme, mais également à travers une relation tout aussi conflictuelle avec la société gréco-romaine. Ainsi, loin d’être monophonique, le christianisme des premiers siècles a plutôt été polyphonique. Cette polyphonie a engendré de nombreux débats opposants différentes mémoires, différentes espérances messianiques et apocalyptiques, et différentes compréhensions de Dieu, de la figure de Jésus et de la relation avec Israël avant que ne se structure une mémoire plus officielle qui garantissait une certaine fidélité à Jésus et à son message. C’est également à l’intérieur de ces débats que s’est progressivement fixé, non sans quelques polémiques violentes, ce qui deviendra le canon biblique et que l’opposition entre « orthodoxie » et « hérésie » s’est construite. Parallèlement, les auteurs chrétiens de discours apologétiques ont tenté d’affirmer la différence du christianisme au sein de l’Empire romain en se présentant soit comme un troisième type de culte, distinct du judaïsme et du polythéisme, soit comme un troisième peuple, distinct des Juifs et des Gréco-romains, ou soit comme une école philosophique distinctes des autres écoles philosophiques qui existaient à l’époque, car sa connaissance ne reposait pas sur une réflexion humaine, mais sur une révélation divine.
Enrico Norelli en arrive alors à la conclusion que les principales raisons qui ont permis au christianisme de durer jusqu’à la fin du IIe siècle et de construire une assise assez solide pour traverser la période de persécutions violentes du IIIe siècle sont : (1) le dynamisme des premiers disciples qui ont rapidement réagi à la mort violente de Jésus en en transformant le sens de manière positive; (2) la poursuite de la mission itinérante de Jésus par ses disciples, mission accentuée par l’espérance que la Parousie – le retour du Messie Jésus – était proche et par la croyance que son message devait dépasser les frontières d’Israël en s’adressant également aux non-Juifs, ce qui conféra à cette mission une « intensité extraordinaire » (p. 360); (3) une activité missionnaire qui allait permettre la mise en place de structures sédentaires assurant ainsi la continuité et le développement des communautés chrétiennes à travers l’Empire romain; (4) une mission adressée aux non-Juifs qui a été facilitée par le délaissement de l’observance de la Loi et de la circoncision, ouvrant ainsi plus largement l’accès au mouvement des disciples de Jésus que n’avait su le faire le judaïsme; (5) des structures permanentes qui ont conduit au développement d’importantes activités de bienfaisance offrant un secours aux plus démunis, répondant ainsi à une lacune du gouvernement de l’Empire romain; (6) un développement du pouvoir mono-épiscopal qui « a garanti un gouvernement centralisé des Églises » (p. 363) et qui a contribué à la marginalisation des mouvements qui s’opposaient à lui; et (7) la construction d’une théologie du Logos et de discours apologétiques qui ont contribué à conférer au christianisme « une responsabilité vis-à-vis du monde et […] la possibilité de collaborer avec ses pouvoirs ».
Si l’ouvrage d’Enrico Norelli est d’une intelligibilité remarquable, il adopte néanmoins dans son argumentaire des positions généralement classiques. À titre d’exemple, l’interprétation qu’il fait de l’Apocalypse selon Jean, qu’il considère comme un écrit qui polémique contre l’Empire romain alors que de plus en plus de chercheurs considèrent qu’il s’agit plutôt d’une polémique interne au judaïsme[3], ou le fait de situer à une date haute l’influence de la birkat ha-minim (p. 243) en ce qui concerne l’exclusion des communautés chrétiennes, alors que l’autorité des rabbins ne semble s’être imposée que tardivement, limitant ainsi l’impact de cette « malédiction » qui visaient, notamment, certains mouvements chrétiens demeurés près du judaïsme. Certaines affirmations de l’auteur laissent également dubitatif, notamment lorsqu’il mentionne que les disciples de Jésus sont « intelligents » (p. 35), une évaluation difficile à mesurer par l’historien, d’autant plus que nous avons très peu d’information sur eux. Il n’est pas certain non plus que Paul ait véritablement voulu, comme l’affirme Enrico Norelli, « léguer un modèle de Dieu qui se dégageait du lien ethnique et de ses marqueurs identitaires », car ce n’est pas Paul, mais sa postérité qui interpréta sa pensée dans cette perspective. D’autres affirmations auraient également mérité d’être étayées, voire appuyées, par une démonstration argumentée, notamment lorsqu’il affirme avec certitude que Paul et les destinataires de son Épître aux Romains pouvaient considérer une femme comme Junia comme une apôtre, au sens technique du terme, en la considérant avec Andronicus comme étant « éminents parmi les apôtres » (p. 94-95). De même, bien qu’il mentionne son caractère hypothétique, mais probant, Enrico Norelli insiste trop, selon nous, sur l’utilisation de la Source Q par les auteurs des évangiles, alors que la reconstitution de cette dernière fait toujours l’objet d’importants débats qui sont loin de permettre un quelconque consensus.
Ces quelques remarques critiques, auxquelles on pourrait ajouter une quasi-absence de notes de référence, la redondance de certains passages en raison de la structure du plan adopté et une bibliographie qui aurait mérité de mentionner les ouvrages parus au cours des trois dernières années, n’enlèvent rien à la qualité remarquable de cet ouvrage qui montre bien que l’émergence du christianisme « fut un processus long et compliqué, et l’entité qui finit par s’imposer ne coïncidait pas du tout – quoi que ses leaders aient voulu faire croire – avec l’ensemble des groupes qui se reconnaissaient dans l’adhésion à Jésus » (p. 14).
Un compte-rendu de Steeve Bélanger
Enrico Norelli, Comment tout a commencé. La naissance du christianisme. Traduit de l’italien par Viviane Dutaut, Paris, Bayard, 2015, 382 page.
ISBN : 9782227487819
Prix : 40,50 $
[1] Pour quelques éléments bibliographiques, voir : https://www.unige.ch/theologie/faculte/collaborateurs/histoire-christianisme/norelli/.
[2] La nascita del cristianesimo, Società editrice il Mulino, Bologne, 2014, 280 p.
[3] Voir, par exemple, L. Painchaud, « Assemblées de Smyrne et de Philadelphie et congrégation de Satan. Vrais et faux Judéens dans l’Apocalypse de Jean (2,9 ; 3,9) », dans A. Pasquier – S. Bélanger – M. Chantal (dir.), Les mondes grec et romain : définitions, frontières et représentations dans le «judaïsme», le «christianisme» et le «paganisme», Laval théologique et philosophique, 70/3 (2014), p. 475-492.





